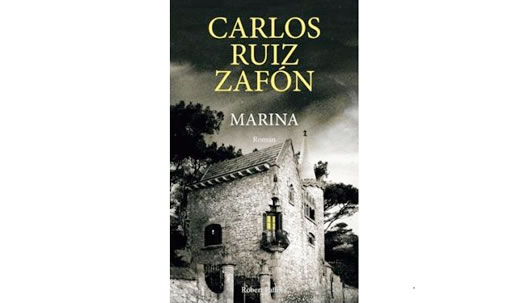«Marina» de Carlos Ruiz Zafon
Par Mohammed Berrezzouk
Des lieux lugubres, des personnages dignes de roman gothique, une atmosphère de terreur, une puanteur acide, des passions assassines, des crimes et des rapts, des mystères déroutants, tels sont, en quelque sorte, les ingrédients qui font de «Marina» de Carlos Ruiz Zafon un roman à sensations.
Depuis les premières lignes, l’écrivain espagnol fait montre d’un don de narration dynamique et captivante. Son récit entraîne subtilement le lecteur dans le monde de l’épouvante où des fantômes fusent de partout et se manifestent à travers les choses : une montre d’or, un antique gramophone, un livre relié en cuir, des photos anciennes, des albums poussiéreux, des morceaux de bois suspendus à l’arpente d’une serre rouillée, etc.
Cette dimension spectrale se corrobore, qui plus est, par le destin mystérieux des personnages. Ici une femme – Eva Irinova -, entièrement drapée de noir, rend visite à une tombe anonyme et estampillée d’un papillon noir aux ailes déployées. Elle s’en retire sans laisser nulle trace et refait surface inopinément en pleine nuit dans d’autres lieux déserts. Rien ne permet de l’identifier ni la faire connaître. Là un homme – Benjamin Sentis – raconte l’histoire d’un crime épouvantable qui a mis fin à la vie de Mihaïl Kolvenik, avant qu’il ne soit à son tour assassiné une semaine après et trouvé, les bras amputés, dans des égouts.
Que ce soient les objets ou les êtres, ils demeurent énigmatiques, menacent de mort qui veut s’en approcher, font perdre au temps son orient et sa mesure, brouillent les espaces, précipitent les curieux dans les abysses.
Sur une toile de fond où le péril, l’angoisse, la solitude, le silence, l’équivoque, le secret prédominent, le bien et le mal entrent dans un jeu scabreux où les destinées individuelles et familiales sont prises au piège. Un jeu où les intérêts des uns et des autres se mettent aux prises, où nul n’est en sécurité, où chacun se tient aux aguets. Un jeu auquel se plaisent non sans peur Marina, l’héroïne éponyme et Oscar Drai, le héros-narrateur.
Comme deux détectives amateurs et improvisés, ils se doivent d’élucider le mystère qui erre autour des crimes commis par-ci par-là, à des époques différentes. Tous deux s’efforcent de démêler la vérité du mensonge, les coupables des innocents, la réalité du rêve. Aiguillonnés par leur amour des énigmes, ils font leur entrée fracassante dans un «décor de cauchemar» où le présent et le passé se recoupent, la vie et la mort se télescopent, l’art et le désastre se font écho, l’amour et la haine se répondent, la lumière et la ténèbre se croisent, les bas-fonds et les hauteurs communiquent.
Tous deux s’évertuent à déterrer les vies antérieures, disparues pour de bon dans les limbes et enveloppées sous des suaires effilochés. Le principe qui préside à leur enquête se résume à ce que Marina a péremptoirement dit à Oscar Drai : «Nous ne nous souvenons que de ce qui n’est jamais arrivé». Qu’ils le veuillent ou non, ils se voient impliqués dans des affaires qui leur sont à la fois étranges et étrangères, qui leur sont imposées par la force des circonstances, qui sont «retenues dans les mailles du passé», qui leur fuient chaque fois qu’ils croient les résoudre.
Tous les deux mènent leurs investigations dans des nuits enlunées et venteuses, tantôt au fond des bois ténébreux et des demeures seigneuriales à demi croulantes, tantôt dans un jardin peuplé de mannequins spectraux et des égouts putrides qui font «penser à l’intestin d’une bête». A tout moment, les lieux enquêtés leur rappellent la mort, la pestilence, les manigances, les cabales et les calculs inattendus.
Parce qu’ils se trouvent dedans, Marina et Oscar Drai ne peuvent ni renoncer à leur aventure ni rebrousser chemin. «Nous avons croisé le chemin de quelque chose, et maintenant voilà que nous faisons partie de cette chose» constate l’héroïne du roman. Une fois ouverte, leur perquisition ne peut se clore avant d’avoir résolu définitivement toutes les équations sibyllines. Ils s’engagent, bon an mal an, dans un labyrinthe insondable que seule leur idylle amoureuse rende supportable et auquel elle donne de la valeur et confère du sens.
De fil en aiguille, le roman baroque de Carlos Ruiz Zafon s’apparente, toutes proportions gardées, au roman policier où Marina et Oscar Drai tiennent le premier rôle. Piqués d’une vive curiosité, ils courent tous les risques pour dévoiler la vérité. Ainsi ils s’interrogent sur la femme en noir et la prennent en filature ; ils cherchent à établir le lien entre elle et les personnages assassinés (Kolvenik, Sentis, Florian) ; ils s’efforcent de décrypter le sens caché du symbole tombal, tantôt inscrit sur la vitre d’une serre tantôt tamponné dans une carte ; ils rencontrent le docteur Joan Shelly à qui ils posent plusieurs questions, etc.
De cran en cran, ils se voient obligés de saisir les ficelles des destins croisés, de les tisser et les détisser. Ils sont contraints de retrouver les pièces du puzzle qui manquaient au début de leur enquête, d’en assembler quelques unes et en écarter d’autres, de les interpréter et en percer les arcanes. Aussi se rendent-ils compte qu’Irinova a été défigurée par Sergueï (son mentor), que Kolvenik (son époux) «n’était ni un criminel ni un escroc, [mais] tout simplement un homme qui voulait piéger la mort avant d’être piégé par elle», que les papillons noirs servent de sérum pour ressusciter les cadavres des morts, etc. Au fur et à mesure que l’enquête des deux personnages avance dans des terrains minés, plusieurs énigmes sont révélées.
A travers leur parcours, leur vision, leur psychologie, leur conversation et leurs voix, le lecteur voit se déployer sous ses yeux l’horreur dans tous ses états. Une horreur qui le prend, de surcroît, à la gorge. Du coup, il est appelé à son tour à s’aventurer avec eux dans des péripéties alambiquées au fin fond d’une Barcelone ancienne, magique et labyrinthique ; une Barcelone où «les rues ont des noms de légende» et où «temps et mémoire, histoire et fiction se mélangent (…), comme des couleurs d’aquarelle sous la pluie». Le lecteur est convié pour ainsi dire à les accompagner, à pas feutrés, dans des venelles reculées et des ruelles ombragées, dans des résidences à l’abandon et des maisons cachées sous les lianes d’arbres colossaux, dans des bâtiments sombres et des chapelles ténébreuses.
Comme Marina et Oscar Drai, il recompose les pièces du puzzle qui se déplacent souvent, qui changent de contours, qui dessinent des lignes nouvelles et des images floues. Le roman de Carlos Ruiz Zafon ne laisse le lecteur ni impavide ni indifférent. Chaque page le tient en haleine, le pousse à poursuivre sa lecture, le sollicite de « trouver, entre les points et les virgules, quelque clef secrète. » En suivant les traces du couple héroïque, il s’emploie à décadenasser les portes de cet horrible univers, en dévoiler les coupables, en connaître les innocents et honorer la mémoire des victimes.
«Et si j’avais tout imaginé ?», s’interroge Oscar Drai dans les dernières pages du roman. Quel sens, in fine, prêterait-on à cette succincte question ? Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle nourrit le flou et l’imbroglio chez le lecteur. Elle fait, par ailleurs, écho à l’assertion de Marina, elle aussi on ne peut plus mystérieuse : «Nous ne nous souvenons que de ce qui n’est jamais arrivé». Avec l’écrivain espagnol, on est confronté à des énigmes qui n’en finissent point. Comme les poupées russes, elles s’emboîtent les unes dans les autres de sorte que réalité et rêve, vérité et mensonge s’entremêlent inextricablement.