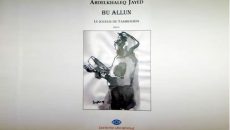Par Abdennour Bouyahyaoui*
«Je chéris mon anathème
Il est la matière de l’œuvre à inventer
du fumier terrestre je voudrais ensemencer mon sol
le tamiser des siècles durant et espérer le rubis éternel
cadavre en décomposition où brille une dent fraîche
le butin de ma recherche
je me laisse pousser le poil de la bête
me déleste du livre que le pinceau de la répétition vernit
de la démarche guindée et des vains fards
crâne rasé, mille lézardes et profondément humain
et pimpant à minuit comme aux aurores
le pétale dressé pour recréer le grimoire ignoré
les reins ceints de poèmes insolents et de joies cruelles
ma plénitude et mon volume
je fonce dans le purin humain avec la passion de me savoir à
la merci d’une mine sournoise
c’est l’orage avant qu’il n’éclate qui me passionne
l’instant qui précède la déflagration
fissure où je palpite de vie»
Poème extrait de « Et je me nourris de vide pour le songe » de Abdelkhaleq JAYED, Virgule Editions, 2017
La poésie a ceci de particulier qu’elle s’adresse moins aux formes communes de l’intelligence qu’à une sensibilité nouvelle et affranchie. Si elle part de la réalité, c’est pour s’en écarter et montrer un monde neuf, selon sa féerie propre. Surtout ne pas demander à un poète d’être« clair», de simplifier, de s’avilir… Ce serait le contraindre à quitter son jardin d’Eden ! Le plus grand péché que puisse commettre un créateur, en l’occurrence un poète, c’est de tenter de vulgariser la braise qui le ronge au-dedans. Car elle est «sacrée» ! Elle n’est recevable qu’à un niveau prononcé d’égarement. Et s’il lui prend la témérité de jeter la Magie dans le râtelier de la commune, il perdrait l’inspiration de ses délires. L’Eden s’évanouirait alors dans la nostalgie douloureuse des origines. Aidons donc les poètes à rester intacts, à couver leur langage et leurs mystères, pour notre bien et pour leur malheur ! Car un poète est une singularité dans la conscience, une brèche dans l’enceinte de l’au-delà, un accès prodigieux au Sens prohibé. Il nous dira après nos quatre vérités, révèlera au jour notre intimité souffreteuse, mais aussi le précieux chemin vers les étoiles. Il n’est pas loin le temps où il était druide, guérisseur ou mystique, le salut de la tribu, l’intercession vers le souffle secret de la nature qu’on redoutait tant. Il acquiert un statut grave, par les temps qui courent, celui de Révélateur !
Le poète Abdelkhaleq Jayed débute ce poème par «je chéris», un verbe qui confine au sentiment intime, si cher aux lyriques. Mais, détrompons-nous, car c’est là une ambiguïté préméditée, occasionnée par la linéarité réductrice du langage, et qui est promptement écartée par la survenue du mot «anathème». Et partant, «chérir» acquiert son vrai sens, celui de l’attachement. L’attachement à la contestation, au refus, à la condamnation… Un acte de volonté, qui ne laisse pas de nous éclairer sur la visée du poète : créer autrement ! Car la création est d’abord une contestation, une remise en cause de ce qui est, afin d’accéder à ce qui se pressent, mais n’y est pas encore. C’est le schème auquel est astreint l’acte créatif en dépit de sa toute-puissance. L’univers large n’a-t-il pas lui-même émergé du chaos ?
«L’anathème»/contestation est alors «la matière de l’œuvre à inventer». Nul besoin de rappeler que le démantèlement précède l’ébauche, au même titre que la tempête de sable, nourrie de dunes effritées, précède la nouvelle dune dorée. Et celle-ci n’est pas seulement belle, mais authentique, car épurée de tout artifice, de toue imitation. Son originalité tient à la richesse du chaos ainsi qu’à la démesure. Le grain de sable, après avoir été malmené dans tous les sens, finit par trouver refuge selon les lois naturelles. Par ailleurs, l’expression «à inventer» souligne la nécessité de l’acte. L’œuvre artistique est, par essence, nécessaire, sans être utile. Car il y va de l’intégrité de la conscience collective. Cette nécessité désintéressée est le propre de l’esprit créateur.
Toujours est-il que le poète se trouve contraint à composer avec les choses du quotidien, insignifiantes en elles-mêmes, mais susceptibles de servir de levain pour un état d’esprit propice au « grand émoi». C’est apparemment le sens s’abritant derrière cette formule : «du fumier terrestre, je voudrais ensemencer mon sol». «Je voudrais», dit le poète, tout humble et révérencieux, conscient de sa petitesse vis-à-vis de l’acte de création, qui émane pourtant de lui. C’est le respect dû au Moule, cette Entité Créatrice Suprême, qui trouve son expression par le biais des gestiques et des termes. Un poète ne pourrait nier l’omnipotence de ce souffle pluriel, dit Inspiration. Il est également conscient de ses choix parmi la panoplie d’affects et de symboles : «le tamiser des siècles durant et espérer le rubis éternel».
Le poète fait état de «siècles» comme durée de son labeur. Serait-ce une exagération pimpante, visant à charmer par le lot de sa « truculence » ? Mais ce serait se méprendre sur la valeur du poète et le réduire à un tribun enjôleur. Le poète s’affranchit non seulement de l’emprise du langage, mais du temps aussi. D’emblée, il impose ses notions et repense les principes à la lumière de sa conscience mise en folie par la flamme créatrice. Le temps n’échappe pas au jeu du marteau et de l’enclume, coule littéralement comme les Montres de Dali, se contracte et se décontracte à volonté. Au fond du chaos, la relativité est le maître mot. Le poète ne reproduit pas, mais révèle par l’intercession de son être. Un être martyrisé par la quête insensée. Et dans sa conscience secrète et embrumée, tout est relatif. Y compris le temps.
Mais dans quel dessein, toute cette peine, qui confine aux maux de la parturition ? Ne cherchons pas loin la réponse ! La quête majeure d’un poète, c’est le surpassement continuel de soi, pour accéder au «rubis éternel». Ainsi, l’ultime projet, c’est de transcender. C’est l’alchimiste entièrement attaché à son «bouillon», qui mijote sur la braise. La transmutation viendra après coup…
Dès lors, l’on appréhende le sens initialement nappé de l’affirmation : «cadavre en décomposition où brille une dent fraîche – butin de ma recherche». C’est probablement la «dent de sagesse», métaphore de la maturité acquise au terme de cette épreuve initiatique, qu’est la plongée périlleuse du poète dans ses propres abîmes !
Mais comment le poète accède-t-il à cette finalité? Par l’entremise de quel précepte occulté? Mais par le biais de sa nature première ! Ses instincts sont autant de prises permettant l’accès à la vérité. C’est à cet égard que se révèle le sens de « je me laisse pousser le poil de la bête ». Approche préliminaire, mais combien cruciale, qui n’est pas exempte de la douleur de se mettre à nu et de clamer sa bestialité originelle, le temps d’une virée aux confins de l’irréel. C’est une percée au fond de soi, afin de permettre le jaillissement des éclaboussures de la psyché. Freud n’a-t-il pas mis l’accent sur l’inconscient, cette boîte de Pandore où s’emmêlent nos «choses» inavouées et bannies, depuis l’abîme de l’être ? A sa suite d’ailleurs, les dadaïstes ainsi que les surréalistes ont payé la part belle au pouvoir souverain de la déraison et du rêve. Ce penchant de véracité et de renouveau chez le poète trouve son expression dans : «me déleste du livre que le pinceau de la répétition vernit». Cette formule est criante de consternation. On y pressent une énergie formidable, de l’allure d’un cri déchirant. C’est aussi une invite grave à s’affranchir de l’emprise sournoise des Ecrits, scellés par les dogmes, embellis par les vaines répétitions. Le langage, artificieux et fardé à outrance, est dès lors perçu comme superfluité vénéneuse. Le poète le prend à parti et lui oppose la simplicité du défardé et de l’authentique. C’est l’émiettement de la charpente charnelle du cocon qui permet au bombyx de jaillir des ténèbres et de déployer ses ailes poudrées et belles.
Le terme «recréer» s’adapte naturellement à ce contexte. Il s’agit d’un réarrangement en profondeur, opéré sur les débris des visions antérieures. «Le grimoire ignoré» est alors remis au goût du jour dans une matrice légendaire : la corolle formée de «pétales», doublée d’un calice où se glisse souvent l’amertume. Car, comme en maïeutique, aucun acte de création n’est prémuni contre l’atroce douleur.
Le poète plongé au fond de son délire est parfaitement lucide à présent. Il aspire désormais aux vérités nues et âpres, impudiques et authentiques. Et ici il n’y a guère de place pour la vulgaire et débilitante pudeur, ce tabou qui empoisonne et altère le sens. Celui-ci est désormais «extrait des reins ceints de poèmes insolents et de joies cruelles».
Prospecter les méandres de la cruauté même est à même de façonner des vérités. Aucun chemin n’est épargné par le poète conscient de la gravité de son acte et de sa nécessité. Disséquer, tailler dans le vif sans modération ni réticence, s’armer de la volonté de puissance ! N’est-ce pas là l’enseignement dispensé, dans un long et épique poème, par le digne Zarathoustra ?
Pas de facilité non plus, ni d’orgueil. Le poète prend de front toutes les incommodités, toutes les épreuves, au point qu’il «fonce dans le purin», exalté, au lieu d’éprouver l’angoisse d’être «à la merci d’une mine sournoise», le destin ! Le poète fait fi de la mort, car il vit indéfiniment, intensément. De fait, chaque instant est pour lui un jaillissement sans cesse renouvelé : «c’est l’orage avant qu’il n’éclate». Et cette violence des origines contrebalance les craintes vulgaires de la finitude de ce quotidien, aussi étriqué qu’une fissure. Paradoxalement, la condition humaine, au lieu d’être une source de complainte, devient pour le poète initié une force créatrice infinie. Il y «palpite de vie!».
*Ecrivain et critique